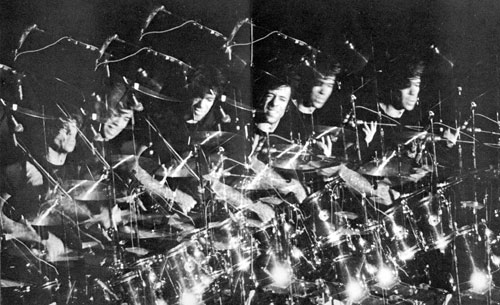|
2
- De la musique considérée comme un promontoire intérieur
Composition
extrême
"Toute
beauté sur cette terre n'existe-t-elle donc qu'en fonction de
son combat avec l'inerte matière du réalisme des intérêts
? Vous, être unique, savez mieux que tout autre avec quels discours
j'aurai dû lutter au cours de ma longue vie pour arracher à
ce monde de plomb une terre pour mon idéal éthéré."
Richard WAGNER (Lettre à Louis II.)
Pour Christian Vander, comme pour tout compositeur digne de ce nom,
la création musicale correspond à un constat intérieur,
à une nécessité vitale sans laquelle il ne saurait
être possible d'entreprendre quoi que ce soit, comme pour répondre
au mot de Rilke (Rainer Maria RILKE, "Lettres à un jeune
poète") : " Confessez-vous à vous-même,
mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire
? " C'est en s'apercevant qu'il lui est physiquement impossible
de survivre s'il ne crée pas de la musique, qu'il s'assoit devant
son piano. Vander, pour parler de son travail de compositeur, emploie
souvent l'image d'un récipient plein qu'il faut d'abord vider
pour que les forces essentielles et dynamiques nécessaires à
la création puissent pénétrer en soi, dégageant
par là même toute idée d'expression personnelle
de la musique. Pour lui, la musique est un art complet, une bague aux
multiples chatoiements, où le langage, le corps, le spectacle
et les notes doivent entretenir des relations d'équilibre. Ses
origines polonaise, allemande et gitane sont déterminantes pour
sa musique et l'approche que l'on peut en avoir. Il serait vain, à
notre sens, de vouloir en faire l'analyse en partant de l'esprit français,
tant il est vrai que chaque peuple a sa perception propre et que si
un Latin ne peut s'empêcher de "s'exprimer" dans sa
musique, il en est tout autrement avec un Vander qui ne considère
pas l'art comme un moyen, mais comme une fin. Cela implique que la musique
n'est pas un langage, et que sa valeur est représentative, plutôt
qu'expressive. Elle n'est pas nécessairement, comme nous sommes
un peu trop habitués à le penser, une traduction des émotions
: l'impressionnisme et le romantisme ne sont pas pour lui les seules
manières possibles d'envisager le monde extérieur. Il
est par contre bien évident que l'œuvre musicale ne peut
se distancier d'une certaine attitude de l'esprit, d'une manière
d'être individuelle, qui sont l'essence même de la personnalité
du créateur. Mais, pour Vander, une chose est certaine : moins
le moi parle, moins il y a de vulgarité, et plus il est possible
de parler d'absolu. Cette idée de vulgarité, qui revient
fréquemment dans son discours, et qui pourrait être mal
interprétée, mérite que l'on s'y arrête pour
dissiper tout malentendu. Elle répond en fait clairement au principe
de la nécessité intérieure énoncé
par Kandinsky dans son magnifique manifeste Du spirituel dans l'Art.
Ce principe premier, moteur de toute création, est lui-même
composé de trois nécessités mystiques progressives
que nous rappelons ici :
1) chaque
artiste, comme créateur, doit exprimer ce qui est propre à
sa personne (élément de la personnalité),
2) chaque
artiste, comme enfant de son époque, doit exprimer ce qui est
propre à cette époque (élément de style
dans sa valeur intérieure, composée du langage de l'époque
et du langage du peuple, aussi longtemps qu'il existera en tant que
nation),
3) chaque
artiste, comme serviteur de l'Art, doit exprimer ce qui en général
est propre à l'Art (élément d'art pur et éternel
qu'on retrouve chez tous les êtres humains, chez tous les peuples
et dans tous les temps, qui paraît dans l'œuvre de tous les
artistes de toutes les nations et de toutes les époques et n'obéit,
en tant qu'élément essentiel de l'art, à aucune
loi d'espace, ni de temps).
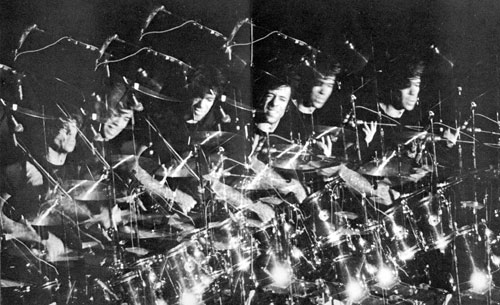
|